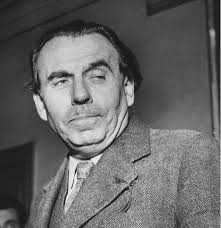Irak, 2006. Paul Conroy, 34 ans, employé d’une société privée de convoyage, reprend connaissance dans une grande caisse en bois qui a tout d’un cercueil. Pour communiquer vers l’extérieur, il ne dispose que d’un téléphone portable.
Le scénario est archisimple et l’idée est séduisante. Depuis « Kill-Bill », les scènes dans lesquelles le héros est enterré vivant sont devenues cultes et ne se limitent plus aux films d’horreur. L’idée de faire un film entièrement sur ce sujet était audacieuse.
La première minute du film, qui se déroule dans le noir, est particulièrement éprouvante. On est bien dans la veine de Tarantino et l’on est presque déçu de ne pas voir Uma Thurman lorsque le Zippo de Conroy finit par s’allumer.
Après le premier quart d’heure qui réussit à maintenir le suspens, on commence à se demander comment Rodrigo Cortès va s’y prendre pour nous tenir en haleine pendant les 80 minutes restantes. C’est alors qu’intervient le téléphone portable et le film se met petit à petit à quitter l’univers du thriller pour glisser vers une critique de l’intervention américaine en Irak. Plus on progresse dans l’intrigue, moins on pense à « Kill-Bill» et plus on pense à « No man’s land » du bosniaque Danis Tanović qui dénonçait en 2001 l’absurdité du conflit yougoslave.
Plus le film progresse et moins on sait plus sur quel pied danser, n’y où on est, au propre comme au figuré. En effet, les activités étant nécessairement limitées dans un cercueil, le réalisateur joue un peu avec les dimensions de la caisse pour servir le scénario.
L’idée de « Buried » est originale, mais la mise en scène souffre incontestablement d’un manque de savoir-faire (c’est peut-être aussi l’acteur qui est pas très bon). L’avant-dernière scène, à la limite du supportable, l’est d’autant moins que l’on ne comprend pas bien son utilité. Incapable de nous faire ressentir l’angoisse croissante de Paul, le réalisateur se sent obligé d’ajouter du trash au trash.
Bref, « Buried » sonne comme un pari raté au terme d’une soirée trop arrosée, à l’issue de laquelle Cortès aurait reçu le gage de réaliser un film dont l’intrigue se déroulerait entièrement dans une caisse en bois. En l’occurrence, je trouve le résultat très moyen. Il est vrai cependant qu’il est difficile d’avoir un avis définitif sur un genre qui, à ma connaissance, n’a d’égal que le vidéo-clip de « close to me » des Cure, qui se passe intégralement à l’intérieur d’un placard. Peut-être que d’autres réalisateurs tenteront l’expérience, donnant ainsi naissance à un nouveau genre cinématographique : le « close-movie ».
Edouard
Rejoignez Azimut sur Facebook en cliquant ici et soyez prévenu de toute nouvelle publication