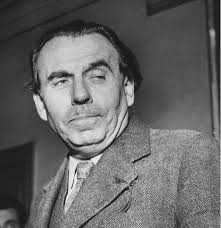La relecture est l’antichambre de la démarche éditoriale. Relire, c’est tout d’abord relire soi-même, mais il y a un moment où l’on sent que ce n’est plus suffisant, un moment où on prend conscience de la frontière indéfinissable qui sépare l’auteur du lecteur. Quand le premier relecteur a terminé son travail, il devient par là même propriétaire d’une vision de l’ouvrage. Une vision que l’auteur pourra comprendre, mais ne pourra jamais vraiment partager. Chacun aura sa stratégie de relecture. Moi, j’en ai choisi une à trois niveaux.
Pour le premier niveau, j’ai trouvé une personne qui a de bonnes connaissances en orthographe. Avis à ceux qui comme moi, étaient abonnés au 0/20 en dictée quand ils étaient à l’école : prendre le taureau par les cornes !! De nombreux moyens existent et je ne saurais trop recommander la lecture de « se réconcilier avec l’orthographe » d’Eddy Toulmé, téléchargeable sur numilog, et qui est très bien fait.
Soigner son orthographe, c’est une question de respect pour son premier relecteur qui, d’ailleurs, verra mieux les fautes si elles sont peu nombreuses. C’est aussi commencer à penser aux maisons d’édition qui seront d’autant plus bienveillantes que le texte envoyé sera soigné. Une fois cette traque aux fautes achevée, il restera peut-être quelques coquilles qui seront corrigées au second niveau.
Edouard
Rejoignez Azimut sur Facebook en cliquant ici et soyez prévenu de toute nouvelle publication.