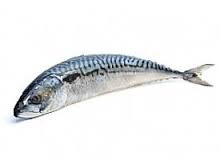Elle se tenait droite au milieu de ce champ d’ail qui surlignait d’un trais vert fluo l’aridité des falaises de Bandiagara. Le pays Dogon, ce paradis préservé de la brutalité occidentale dont on m’avait parlé, l’un des derniers havres de paix de notre planète.
Lorsqu’elle nous vit, elle se mit à faire des signes en s’approchant. On finit par comprendre ce qu’elle voulait. Elle avait une grosse conjonctivite et avait besoin de collyre pour ses yeux.
Ça se passait en 2005 et se fût une révélation. On m’aurait menti ou peut-être que le tiers-mondisme béat ambiant des années 80 se mentait à lui-même. Certes, l’homme blanc avait industrialisé l’esclavage, pillé les richesses de l’Afrique, avait contraint le continent à épouser des frontières et une religion qui ne lui appartenait pas, mais n’était-ce que cela ? Était-ce si indispensable de préserver les « merveilleux » indigènes de notre dévastatrice civilisation, les maintenir où ils étaient, sans leur demander leur avis ? Cette bienveillance naïve qui imaginait s’opposer au colonialisme en conservait en fait ce que le petit blanc des colonies avait sans doute de pire : la condescendance.
L’islam, religion des indigènes, obéit aux mêmes règles. Au moins autant que l’islamophobie, la bienveillance naïve et condescendante fait le lit de l’islamisme qui séduira tous ceux qui se sentent méprisés et mis à l’écart de la société. Certes, nos aînés ont perdu les colonies, mais ont continué à considérer les immigrés comme des indigènes.
J’ai pu donner du sens au choc provoqué par l’épisode de la femme Dogon quelque temps après sa rencontre en discutant avec des jeunes maliens au chômage et un guide à Tombouctou : l’homme blanc avait aussi apporté la prise de conscience de possibilités d’un « mieux-être », de possibilités inouïes permettant de vivre plus longtemps et dans de meilleures conditions et ça, de l’aborigène au cheyenne en passant par le pygmée et l’esquimau, personne n’est contre.
Le discours convenu en France concernant l’islam s’attache à la condition de la femme, on parle de burqa et des talibans, mais ce sont d’autres cultures. On ne parle jamais de la musulmane de la rue, celle qui vit en France au XXIe siècle et qui s’efforce de conjuguer les exigences de sa religion, le poids de la société et les possibilités d’épanouissement personnel qu’elle offre.
Pourquoi n’en parle-t-on jamais ? Parce qu’elle est trop bête pour comprendre que sa religion l’oppresse ? Parce que ces charmantes indigènes qu’il faut préserver ne voient pas le mal, ne comprennent pas toutes ces histoires d’émancipation que les Françaises de souche construisent depuis 50 ans ?
Personne n’échappe aux sirènes du « mieux-être », les islamistes le savent et leur combat ne peut être que d’arrière garde. La peur de l’invasion musulmane est souvent évoquée sur les réseaux sociaux. L’histoire de l’islam qui dévore l’occident est celle de la grenouille qui dévore le bœuf, mais qui, en définitive, finit par ressembler plus à un bœuf qu’à une grenouille. Les musulmanes chercheront forcément ce mieux-être pour elles et pour leurs enfants et si l’islam s’y oppose, elles changeront l’islam.
Édouard